RECUEIL - Au temps en emporte le vent : Judith Chavanne, "De mémoire et de vent"
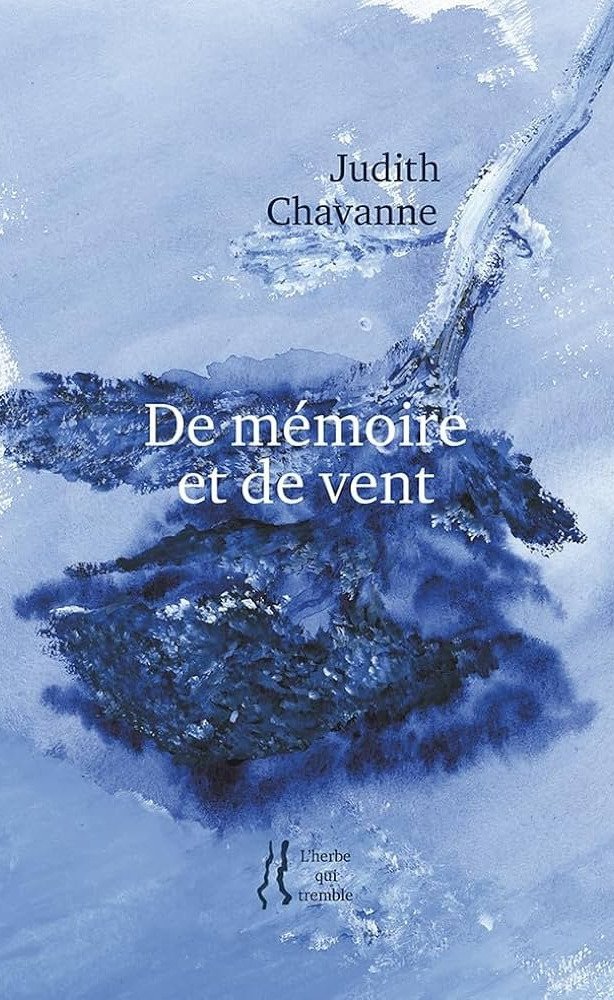
Courlon-sur-Yonne, mercredi 24 janvier 2024
Très chère Judith Chavanne,
J’ai lu votre recueil De mémoire et de vent. Je reconnais là une manière d'évocation (ce que l'on appelait autrefois un style) remarquable, qu'il est passionnant d'explorer.
Je ne peux m'empêcher (j'ai peut-être tort) de voir certaines lignes de cheminements proches de celles de Philippe Jaccottet, à qui vous avez consacré votre thèse de doctorat. Vous avez en partage l’attachement aux évènements les plus imperceptibles, ce désir de ne pas renoncer aux plus infimes hésitations. Les épanorthoses qui jalonnent votre texte en sont, je crois, un bon exemple : "Le regard s’y perdait, ou plutôt se fondait dans ses nuances". Vous êtes restés, semble-t-il, dans une entière complémentarité et j'espère que l’on reconnaîtra sans mal, si ce n’est déjà fait, que vous lui avez succédé, de façon entièrement nouvelle ou du moins renouvelée, admirablement.
Je ne force pas la filiation. Je la reconnais, la souligne et la salue même, car elle éclaire le si beau titre qui couronne votre recueil et qui vous place d’emblée, courageusement, dans une destinée tragique que le poète était forcé lui-même de nous révéler, faute de pouvoir retenir le temps, la beauté, les souvenirs, les mots même. Ne commencez-vous pas ainsi : "On a moins de mots désormais" ? Vous soulignez là avec beaucoup de justesse cette crête oxymorique sur laquelle nous vivons, et que nous oublions parfois. C’est cette tension qui revient à l’esprit de la poétesse que vous êtes lorsque vous reconnaissez que le jardin dans lequel s’inscrivent vos évocations – qui est moins, me confiez-vous, un décor (un changement de décor même au fil du temps) qu’un compagnon – porte en lui ces forces opposées, celle de la "mémoire" qui s’ancre (et s’encre) et celle du vent qui menace de tout effacer, comme si une porte se refermait à jamais : "quelque chose est inaccessible".
En cela, vous justifiez "toute la gravité" de vos mots et les titres même des sections qui composent votre livre, dont le premier est peut-être le plus révélateur : "Les éphémères". L’usage du « on » peuple votre solitude et nous sommes, avec vous, embarqués dans l’observation des arbres, des plantes et des fleurs qui, bien avant le vent, poussent le temps et vos rendez-vous à leur fin. Ainsi retrouve-t-on dans l’attention portée aux iris, exprimés dans un subtile hypallage associant la floraison aux adieux, ces mouvements contraires que vous annoncez dès le titre du recueil : "On les voit dans l’éclosion /qui épanouissent / déjà leur adieu." L’expérience d’une réminiscence de l’enfance — les voix, les couleurs, les jeux, les objets simples, une coquille d’escargot, une fleur d’édelweiss — n’est pas impossible cependant, à condition de se placer en observateur patient et sensible : "c’est l’évènement d’un jardin un instant / et de qui le regarde, / l’évènement d’un âge […]." Le temps n’est plus seulement fuite, il n’est pas ennemi du souvenir, porteur de seuls regrets où l’enfant que vous étiez "ne [vous] prend plus par la main", mais le medium par lequel s’exprime la plus touchante harmonie poétique : "Avec le temps s’approfondit / l’espace de résonance ; il n’y a peut-être pas de moindre ni de plus grand." Vos souvenances n’excluent pas les rêveries où l’on emprunte tout pouvoir au merveilleux : "on commande aux arbres de marcher." Vous choisissez, et c’est réconfortant, le côté de la lumière et reconnaissez que la valeur des rencontres ou des évènements est plus appréciable encore lorsque le temps s’est écoulé. Alors, face au "rien" qui menace inexorablement, que l’on remarque "un matin", et à la mort à laquelle on n’échappera pas en définitive, vous "mendi[ez]" — parce que vous résistez tout de même courageusement — un secours, un sursis peut-être ("l’aumône d’un avenir"), à travers tout ce qui s’inscrit dans la "durée", dans une "continuité", et dont vous avez pu vous repaître. Partageant vos tiraillements et ne cédant pas au désespoir, l’on bascule dans "Tout l’inassouvi".
Cet inassouvi – ou plus précisément, le sentiment de l'inassouvi –, qui perdure parfois, ténu, n’ayant pas "reçu sa durée", n'est pas étranger à votre rapport sensible et délicat au monde. Vous explorez les mystères qui entourent le jardin sans pour autant les dissiper, acceptant même une forme de soumission ("Il n'y a rien à dire / une saison est donnée à nos deuils") en leur accordant une part d'inexpliqué, ou plutôt d'irrésolu. Excusez-moi d’insister, chère Judith, je ne résiste pas à la tentation de partager avec vous un passage de Jaccottet que vous connaissez assurément, qui m’est cher et auquel j’ai repensé en lisant "qu’une main – trop tôt – déroba la beauté". Vous le trouverez dans « Les Eaux et les Forêts » (IV) :
Toute autre inquiétude est encore futile,
je ne marcherai pas longtemps dans ces forêts,
et la parole n'est ni plus ni moins utile
que ces chatons de saule en terrain de marais :
peu importe qu'ils tombent en poussière s'ils brillent,
bien d'autres marcheront dans ces bois qui mourront,
peu importe que la beauté tombe pourrie,
puisqu'elle semble en la totale soumission.
C'est drôle avec quelle facilité vous bouclez vos boucles, tressant sans marque quelconque ni de votre effort, ni de vos effets, les fils de vos évocations, clair et sombre mêlés. Vous avez pour conclure la section ces mots magnifiques : "Seule alors grandit notre solitude." Le temps néanmoins n’est pas qu’un long fil entremêlé ou coupé en quelques endroits. Il est une nappe incertaine, "transparent[e]", vous plaçant dans "le vide et le vague", mais aussi dans le silence. C’est pourtant là qu’aidée de vos souvenirs, vous entrevoyez le mieux ce qui reste pour beaucoup imperceptible, et que vous avez accès aux choses les plus fugitives, dont vous mesurez l’immense et l’éphémère fragilité, comme au passage d’un oiseau : "de cette visite qui / n’est déjà plus qu’un souvenir / lui-même qui s’amenuise." Vous soulignez alors avec beaucoup plus de finesse que je ne le dis ici, la présence de l’absence qui, confiez-vous, "fleurit seule dans l’air."
Le titre gidien de la nouvelle section ("Quelque chose de fervent") n’introduit aucune radicalité. Il confirme plutôt votre goût pour la nuance et le balancement, pour l’hésitation duale que j’évoquais au début. Lucide d’un côté vis-à-vis de ce qui manque et de ceux qui sont partis ("quand la mère n’est plus"), vous vous placez en retrait, prudente : "Elle sait bien qu’il ne faut surtout pas trop / en faire maintenant, ni trop inventer / plutôt céder l’initiative". D’un autre côté, vous êtes prise d’un élan vital ("quelque chose de fervent", un "regain") que vous nommez avec force et assurance "une renaissance". C’est à travers elle que vous offrez dans les dernières pages du recueil, où vous vous ouvrez généreusement au lecteur, les signes les plus subtiles et les plus émouvants de votre sagesse.
Il n’est pas improbable, soyez-en assurée, chère Judith, que l’enfant qui "vit / au rythme frémissant de ses désirs" soit tentée d’étirer le fil du temps jusqu’à vous, et qu’elle vous redonne la main.
Avec toute mon amitié,
David Dielen
Judith Chavanne, De mémoire et de vent, L’herbe qui tremble, 2023, 73 pages.
Tous droits réservés ©