RECUEIL - Itinéraire du vivant : Béatrice Pailler, "D'un pas de luciole".
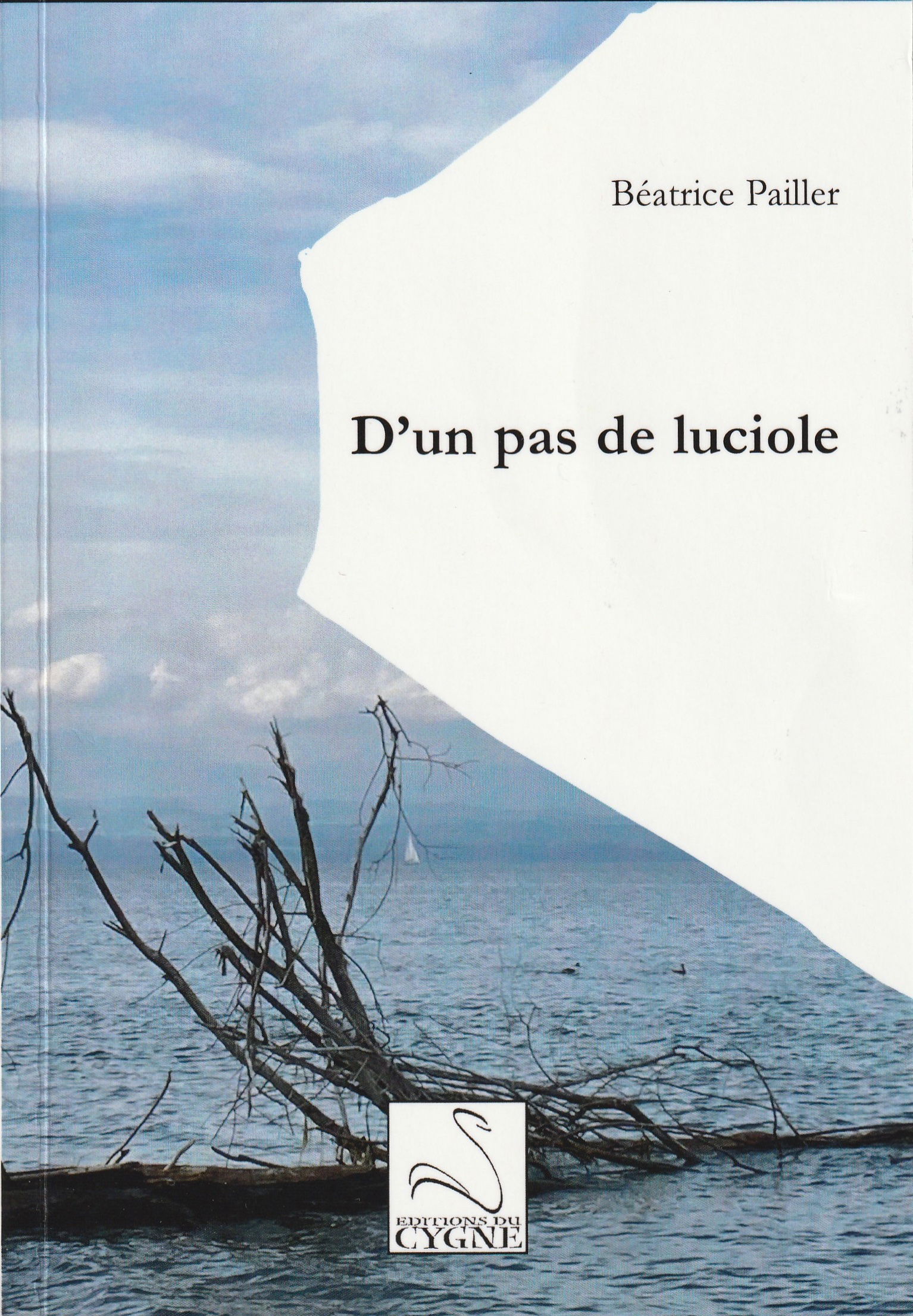
Les courtes parties en prose qui forment le recueil de Béatrice Pailler s'inscrivent sur la page comme les empreintes laissées par ce pas régulier et délicat auquel le titre fait référence. C’est une cadence qui rythme le texte ; il est moins ici un mouvement de l'avant, une conquête, qu'une progression lente comme l’est celle des lucioles. Aussi le pas se joue-t-il du temps "chahut[é]", tout en mimant "[s]a juste mesure" : "le temps avance, [...] son pas a force loi". Il fixe l'état imprévisible et mouvant des choses et des êtres qui se manifestent selon leur destinée, poussant la poète à conclure d'abord stoïquement : "ainsi le monde".
À la manière du texte de Jean Giono, placé en exergue de l'ouvrage, et à qui la poète voue une grande admiration, le fil d'Ariane du recueil est la vie ou plus exactement la célébration de la vie : "Racines et tiges s'entremêlent. Chairs et souffles s'entrelacent. Les bêtes ruent, les arbres suent, chacun réclame son jouir [...]". Très souvent, il est fait écho au corps et à ce qui l'entoure, le tout situé en pleine chaleur, en pleine lumière, selon diverses déclinaisons lexicales et poétiques : "chaire de lumière", "puits de lumière", "corps [...] de lumière", etc. ; mais aussi "lumière [...] de l'instant", "lumière qui infuse", etc. À tout cela s'adjoignent, comme pour sublimer ce bouquet de vie chaud, coloré et luminescent, d'autres signes du vivant : "Sève et sang", "bourgeon", "racines" et "semences".
Pourtant, le recueil n'exalte pas seulement le côté lumineux de la vie. La réalité de son architecture est plus complexe. Certes, l'on perçoit bien le tout visible et réel à l'état naissant, en pleine éclosion mais la poète n'oublie pas son déclin inéluctable qui rendrait vain, s’il n’advenait pas, tout chant, toute célébration de la vie.
Songeons un instant à ces mots de l'historien Fernand Braudel, prononcés lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en 1950, et qui, semble-t-il, font écho au recueil : "J'ai gardé le souvenir une nuit […] d'avoir été enveloppé par un feu d'artifice de lucioles phosphorescentes : leur lumière pâle éclatait, s'éteignait, brillait à nouveau sans trouer la nuit de vraie clarté." Il ajoute : "l'obscurité reste victorieuse." Celle-ci infiltre ainsi inévitablement le recueil, dans toutes ses nuances et ses dégradés : d'abord ses signes annonciateurs ("[...] l'horizon vacille incertain de vivre.") ; puis ce quelque chose – ce je ne sais quoi dirait Jankélévitch – qui s'imprime dans l'instant avant qu’elle ne se fasse toute entière, modifiant ainsi le paysage ("Le sombre tamise la neige [...]"), l'estompant puis l'effaçant pour ne laisser que le tableau noir de la nuit ; enfin l'obscurité, dans son extension peut-être la plus difficilement perceptible, celle de nos organismes ("Corps d'ombres" et "Étendue sombre dans nos chairs").
Cette architecture poétique reconstituée ici se révèle être le pivot de la recherche poétique d'une langue propre à l'évocation de la vie dans sa dimension sensible, métaphysique, mystique même. Qu'est-ce que cette langue pourrait-elle parvenir à nous dire ? Que pourrait-elle nous transmettre ?
La poète s'interroge d'abord sur le mystère de la langue dans sa forme primitive, la « protolangue » en quelque sorte "d'avant le temps compté [...] des hommes", mais déjà insérée dans la nature qui conserve en mémoire ses plus anciennes manifestations. Ainsi, l'on est sensible d'abord aux simples "bruits", murmures ou bien aux "note[s]", "chants", "paroles", "cris", "rires", constitutifs des décors de lumière, contrairement au mot "silence", associé plutôt à l'obscurité, à ce qui s'en va, s'éteint, et ce, malgré les quelques sons qu'il transporte (les "trilles") ou le "bercement" qui l'accompagne.
Le recueil ne cède pas pour autant au manichéisme. L’architecture se double d’une sculpture plus subtile et nuancée. Dépassant la structure apparente, l’on ralentit encore le pas, discernant ce que chaque élément de la nature, soumis au passage et aux aléas du temps, contient à la fois d'imbrications, de subtiles variations et de significations symboliques que la poète tente, dans l'instant, de saisir. Aussi parvient-elle à éclairer certains mystères ("les sentes de vos pas remontent l'énigme du jour") en apparentant parfois son texte poétique à une sorte d'homélie, à un acte de foi : "le poème, dernier chant avant l'infini."
Ne pouvant ralentir davantage pour "s'extraire des rapides du temps", notre pas devient plus bruyant ("nos regards se brisent de révolte"), les évocations poétiques se font plus dures ; l'on résiste de toutes nos forces, mais en vain. La poète le concède : "l'homme a si peu", tout est emporté par le vent, par le temps contre lequel finalement on ne peut rien ; à moins que ce ne soit le contraire, que tout renaisse et que "du sombre au clair, œuvre le temps".
David Dielen
Béatrice Pailler, D'un pas de lucioles, Éditions du Cygne, 2024, 58 pages.
Tous droits réservés ©