RECUEIL - La fugue comme langue éco-poétique : Marine Riguet, "Fugue pour visage"
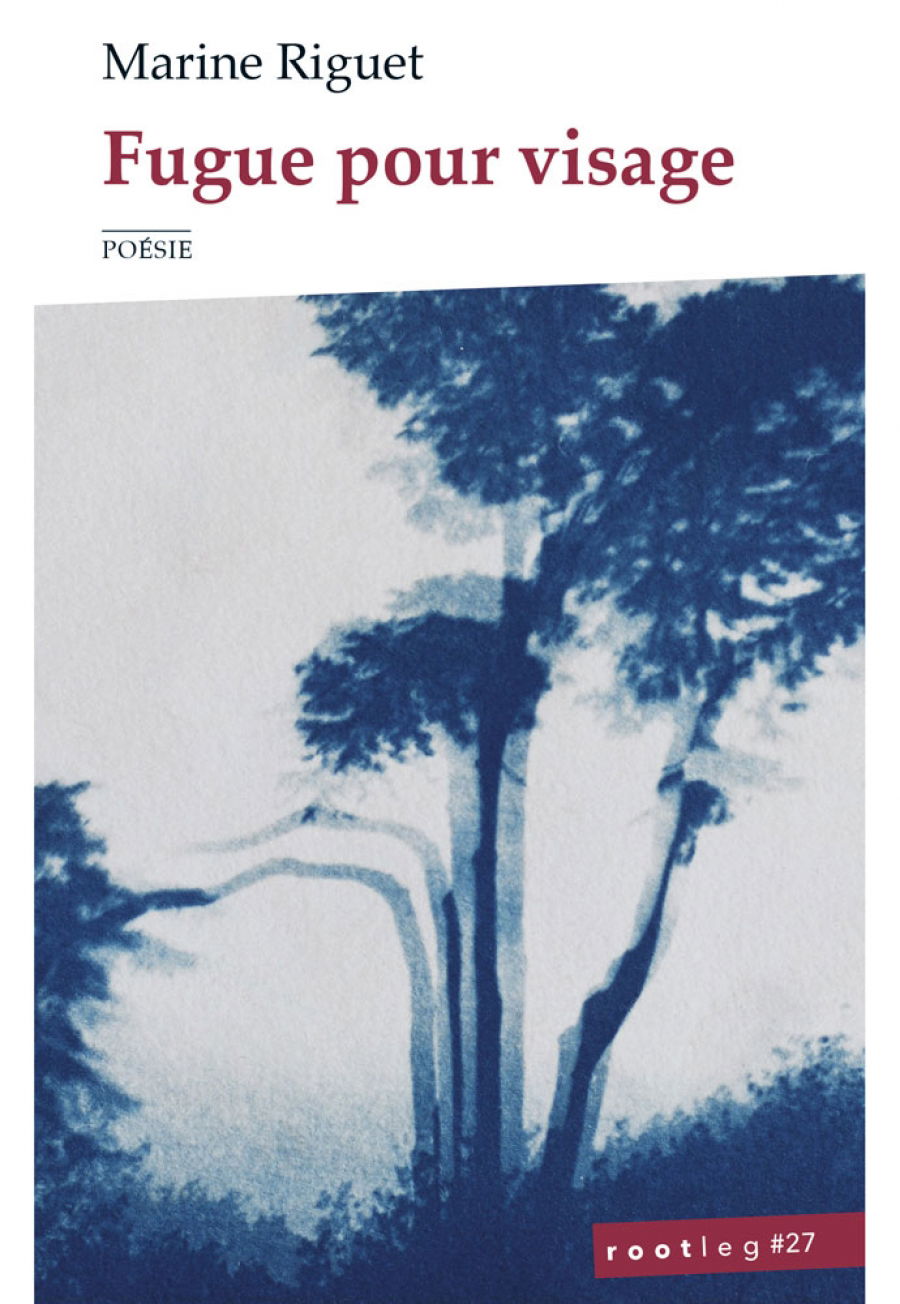
Par la mention en première page d'Atlas, personnage de la mythologie grecque, la portée cosmologique de ce long poème s’impose à l'esprit du lecteur qui le découvre. La catastrophe naturelle outrepasse toutes les limites du concevable et du supportable pour les êtres humains, confrontés à ces manifestations extrêmes de la nature, à qui l'on aurait tort, dans un réflexe de projection anthropomorphe stérile et déculpabilisant, de lui reprocher un caprice, une colère, une intention même de punir l'humanité, voire de la faire disparaitre. Les deux premiers vers, d'une densité remarquable, suffisent à nous immerger dans "le bruit", "l'obscurité", les forces naturelles qui font "céd[er]" ce qui paraissait immuable, inaltérable comme les mythes eux-mêmes. Ceux-ci racontent la création, l'origine des hommes et des choses, l'équilibre même de tout l'univers qui les contient, et force est de constater que cet équilibre s'effondre. Le cataclysme est une fin du monde ou d'un monde que la poète, témoin angoissée (comment ne pas l'être ?) de tout ce qui est emporté, a le courage de décrire et d'investiguer au cours et au cœur même de la catastrophe qui emporte tout, y compris ce qu'auparavant, dans sa plus belle création, la poésie parvenait à saisir et dire, toute une langue désormais hors d'âge, archaïque, à réinventer.
Alors que le vent se lève, gronde, "monte" et fait éclater la terre ("il soulève nos sols"), la poète éprouve une première atteinte au corps, les premiers signes d'un être-au-monde désinscrit de son milieu, lui-même disparu : "les yeux ne savent plus lire" ; puis immédiatement après, sur l'autre page, comme une réalité soudaine, autant révélée par la catastrophe que par son symptôme, la cécité : "ma ville n'existe plus". À l'image du cou des arbres, troncs et branches souffreteux et prêts à rompre (la photographie de la couverture le montre bien), le "décor", exsangue, devient trouble : "les lieux de brouillent les uns contre les autres" ; l'étoile éclairant le monde, le réchauffant, est près de choir, dans une vision apocalyptique. Au bord du néant, la poète confie, comme hallucinée, devant ce temple immémorial désormais vacillant de la nature : "rien du pilier qui tenait le soleil debout / rien".
Dans un rapport au temps bouleversé, "refermé" (le terme est juste), les matériaux détruits et déplacés ("fenêtre cassée", "portail", etc.) se confondent à la matière organique des êtres : tapage des morts et des corps penchés ("[l]es vents longs appuyés sur eux") et parfois si disloqués, comme "des morceaux branlants d'écorce", qu'ils disparaissent ou ne sont plus que métonymie du corps : "visages", "mains", "bras" et "jambes", "dos" et "ventres", "bouches" et "langues" se succèdent dans un décor dévasté, comme impossible à réédifier autrement qu'en recourant à des images quasi surréalistes ("les villes continuent de tomber une à une / dans nos bouches [...]. arrachées / des murs dans nos bouches.") ; à moins que la poète se lance en quête d'une langue nouvelle d'où transparaîtrait un nouvel espoir. La catastrophe semble pourtant en avoir fait disparaître toute trace, même originelle, c'est-à-dire dans ses plus anciennes formes résiduelles, à l'image de ce que nous pouvions lire encore à la surface d'un terrain (une "langue meuble") et, plus profondément, dans chaque strate géologique ("les reliefs et les stries ont passé [...] des carriers [...] fouillent en vain [...]"). Gestes, bruits et cris entremêlés se substituent un temps à la langue, à la parole coupée, rompue, au récit ("on ne raconte plus."). La langue poétique est inhumée avec les morts ou plutôt en eux-mêmes : "les langues s'enterrent / au fond des corps que rien ne vient remuer." Feue donc la langue !
C'est pourquoi peut-être, la phrase (sans majuscule) est parfois segmentée, librement agencée. Il naît alors un autre rythme poétique, une cadence remarquablement maîtrisée par la poète, comparable à celle d’une fugue susceptible de maintenir une langue échappant à la catastrophe, au vent qui la ferait définitivement disparaître : "détruire puis." ; "là où / les corps rentrent." ; "se répète" ; "l'idée d'un ventre.", etc. Ne renonçant donc pas à réinitialiser* la langue, la poète est attentive au moindre signe, à la moindre entrevision : "parfois une voix de loin en loin / paraît [...]" La vue revient progressivement puis complètement, le soleil est à nouveau soutenu : "on / écarquille les syllabes" [...] debout dans l'été". L'on s'initie à une langue toute neuve. Un souffle de vie succède à la tempête : "toute chose / est appelée à faire jour [...]" et "le paysage mue." L'on retrouve nos principaux repères, nos équilibres ("les points cardinaux se réagencent") et l'on cherche une place nouvelle dans le monde. Songeant au principe ordonnateur du cosmos, la poète aurait pu conclure : au commencement était le Verbe.
David Dielen
* Au sujet de Marine Raguet, l'éditeur indique : "Depuis plusieurs années, une part importante de sa recherche poétique et théorique est consacrée aux écritures intermédiales, en particulier sur le web. Ses poèmes-vidéos sont publiés sur sa chaîne YouTube".
Marine Riguet, Fugue pour visage, MaelstrÖm reEvolution, rootleg #27, 2025, 61 pages.
Tous droits réservés ©